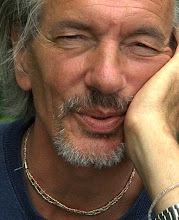Le cycle du port… (d’arriver à bon)
Le porc est un animal qui arrive à sa maturité sexuelle à six mois. Ce qui fait qu’il a un cycle de vie assez court. Il est aussi une denrée très recherchée sur le marché des nourritures terrestres. De par la brièveté de sa vie, il est facile de montrer le jeu qui existe entre l’offre et la demande de sa viande et, partant, de la manière dont les marchés fonctionnent pour trouver un équilibre (réputé instable) entre une offre pléthorique et une demande excessive. Cela s’appelle, le cycle du porc. C’est très connu.
Il est d’autres cycles dans la vie. Il semblerait d’ailleurs que la vie ne soit faite que cycles. Déjà l’Ecclésiaste disait : “Et le vent revient sans cesse sur les cercles qu’il a déjà tracés…” Et dans le grand cycle de l’histoire de l’homme qui se résout à la charade inventée par une chimère, il est d’autres cycles, qui confèrent à l’existence quelque chose de « déjà-vu » et donc, d’universel, que ce soit par le biais du codex des maladies infectieuses, le cycle des fièvres, ou le cycle des naissances et des guerres, le cycle des moissons, et partant du cycle de l’Education nationale tel qu’il se présente encore en France sur la base d’une population, jadis, essentiellement agricole ; et ainsi de suite… Toutes ces météorologies faisant le monde à leur façon…
Il est un cycle peut-être plus universel que celui des civilisations, auquel bien peu semble échapper, et ce serait celui de l’accomplissement. (Je ne trouve pas d’autres mots.) On pourrait le rapprocher à celui très moderne des retraites ; une invention de Bismarck qui a transformé l’Europe occidentale d’une façon peut-être plus radicale qu’il ne l’avait souhaité, puisque, à l’origine, il s’agissait de battre les socialistes à leur propre jeu. Ainsi, la Sécurité sociale serait une espèce d’ersatz du Christianisme propre à faire croire à l’homme que le Paradis est à sa portée. Que son travail a du sens… Un sens qui lui est personnel et qui exaucera ses rêves - dont la Justice immanente ! Bref ! un cycle qui stipule que tout sacrifice est payé de façon sonnante et… trébuchante !
Celui dont je veux parler est sans doute plus court que ceux aménagés par les fonds de pension et autres organismes de prévoyance des pays opulents.
Il serait comparable à cette illusion que la fatigue fait croire, à tort, aux alpinistes qu’ils sont proches du sommet tant convoité. C’est un cycle qui peut se comparer à celui du BTP, de par sa brièveté : généralement, une génération. En général, cette comparaison se renforce de l’adage qui affirme que qui a terminé sa maison, meure.
Il s’agit d’un cycle obscur, erratique, charnel, dans le sens ou le désir de la chair est cérébral.
Un cycle ancré à la vie, car il est mortifère. Mais plutôt que la personne, c’est la chose qui meure ; un concept. La joie, par exemple ! Celle du retraité qui l’a perdue, dès qu’il est rentré chez lui du bureau qui lui est maintenant interdit. A moins que ce ne soit un destin : Un enfant né de la lassitude d’amants qui refusent de se quitter, par exemple…
C’est un cycle où le temps n’est pas une constante. Mais où la constante donne la durée.
C’est un cycle auto destructeur. Mais, il ne faut pas l’achever, car il n’y survivrait pas. Sa graine est abondante, son fruit est amer. C’est un déjeuner de soleil, lorsque le dernier oiseau s’est tu et que le soir est un départ.
C’est le rêve de notre solitude à son réveil. Il suffit d’espérer et il recommence…
A ce propos, ces vers de East Cocker, par T.S. Eliot
Not the intense moment
Isolated, with no before and after,
But a lifetime burning in every moment
And not the lifetime of one man only
But of old stones that cannot be deciphered.
There is a time for the evening under starlight,
A time for the evening under lamplight
(The evening with the photograph album).
Love is most nearly itself
When here and now cease to matter.
Old men ought to be explorers
Here or there does not matter
We must be still and still moving
Into another intensity
For a further union, a deeper communion
Through the dark cold and the empty desolation,
The wave cry, the wind cry, the vast waters
Of the petrel and the porpoise.
In my end is my beginning.
mardi 24 août 2010
mercredi 27 mai 2009
Banalités
Ma mère disait souvent qu’à Paris le beau temps ne durait pas. Elle avait souvent raison. “Trois jours ! et c’est irrespirable, puis c’est l’orage…” Cela m’évoquait mes vacances à la campagne et ces orages qui venaient tout gâcher alors que tout était si bien. Nous les voyions venir du fond du champ avec leurs nuages noirs et leurs éclairs orange sur un fond de ciel bleu de Prusse. J’aimais assez la foudre et le tonnerre. C’était après que l’ennui venait. Avec la pluie. De celles qui réjouissaient les paysans. À moins qu’elle ne tombât juste avant les moissons.
Je ne sais pas pourquoi tout cela m’évoque la guerre et la douleur. Ce que j’ai connu de la guerre était un grand bonheur. Lorsqu’on est enfant, on ne souffre pas de la faim, ni du froid. La chaleur, si, un peu, parfois.
La guerre pour moi fut la liberté. Elle m’évoque l’été. Parce que j’aime Francis Lemarque et Yves Montand, je sais que c’est à cette époque qu’elle commence : “Pourtant, c’est presque toujours/ quand revient l’été,/ qu’il faut s’en aller./ Le ciel regarde partir:/ ceux qui vont mourir:/ au pas cadencé…/ Les hommes, il en faut toujours,/ car la guerre,/ car la guerre,/ se fout des serments d’amour/ elle n’aime que l’son du tambour…”
N’est-ce pas paradoxal que je fus heureux alors qu’Odile et Claude et quelques millions d’autres étaient battus, torturés dans les camps. Qu’une grande partie du monde se déchirait…
Étrangement, cela me fait penser à l’amour. Quelques fois…
Aurais-je connu plus de femmes, en saurais-je peut-être plus ? Peut-être que non…
Parce qu’à un certain moment c’est la violence et la douleur qu’il faut donner. Jusqu’à l’épuisement. Je me souviens encore de cette nuit où j’ai bien cru te tuer tant tu exigeais de moi. C’est à peine si j’eu les moyens physiques. Mais, après !… Après que je fus redevenu homme, et non cette chose que tu avais forcée… Croyant te voir pleurer, craignant tes reproches, tu me souris. Ce sourire… Comme jamais…
Je n’ai vu ce sourire dans aucune nativité ; des plus grands maîtres aux quelques-unes, bien réelles, celles-là, auxquelles je participai…
D’autres scènes d’amour, sans doute moins brutales, soulèvent aussi pour moi un voile sur cette compagne que nous n’osons plus nommer aujourd’hui : la douleur.
Certains de mes plus beaux moments d’amour furent les plus douloureux. (Oh ! mais j’ai aussi souvenir de bonheurs d’une qualité si rare qu’ils se présentaient sans même être convoqués…)
Je ne pense pas souffrir de trop de déviances. J’ai une imagination banale qui s’étonne parfois de ce qui est vendu en librairie. Sade m’ennuie. Gilles de Rais me terrifie. Je n’aime pas les frasques de Louis XVI et son Parc aux cerfs, les revues… suédoises. Mais, force est de constater, pour paraphraser Frère Friar, dans Roméo et Juliette que :
… Deux tels souverains rivaux [le vice et la vertu] incarnent
Dans l’homme, comme pour les simples, la grâce et la violence ;
Et je ne suis pas sûr d’adopter la fin :
Et là où le pire domine,
Bien vite le chancre dévore la plante.
… car je me rappelle l’innocence de tes traits quelques secondes une fois que tu fus revenue au monde. Et la banalité de nos vies mutuelles ne m’offre, à ce jour, aucune réponse à ces noces tragiques…
Je ne sais pas pourquoi tout cela m’évoque la guerre et la douleur. Ce que j’ai connu de la guerre était un grand bonheur. Lorsqu’on est enfant, on ne souffre pas de la faim, ni du froid. La chaleur, si, un peu, parfois.
La guerre pour moi fut la liberté. Elle m’évoque l’été. Parce que j’aime Francis Lemarque et Yves Montand, je sais que c’est à cette époque qu’elle commence : “Pourtant, c’est presque toujours/ quand revient l’été,/ qu’il faut s’en aller./ Le ciel regarde partir:/ ceux qui vont mourir:/ au pas cadencé…/ Les hommes, il en faut toujours,/ car la guerre,/ car la guerre,/ se fout des serments d’amour/ elle n’aime que l’son du tambour…”
N’est-ce pas paradoxal que je fus heureux alors qu’Odile et Claude et quelques millions d’autres étaient battus, torturés dans les camps. Qu’une grande partie du monde se déchirait…
Étrangement, cela me fait penser à l’amour. Quelques fois…
Aurais-je connu plus de femmes, en saurais-je peut-être plus ? Peut-être que non…
Parce qu’à un certain moment c’est la violence et la douleur qu’il faut donner. Jusqu’à l’épuisement. Je me souviens encore de cette nuit où j’ai bien cru te tuer tant tu exigeais de moi. C’est à peine si j’eu les moyens physiques. Mais, après !… Après que je fus redevenu homme, et non cette chose que tu avais forcée… Croyant te voir pleurer, craignant tes reproches, tu me souris. Ce sourire… Comme jamais…
Je n’ai vu ce sourire dans aucune nativité ; des plus grands maîtres aux quelques-unes, bien réelles, celles-là, auxquelles je participai…
D’autres scènes d’amour, sans doute moins brutales, soulèvent aussi pour moi un voile sur cette compagne que nous n’osons plus nommer aujourd’hui : la douleur.
Certains de mes plus beaux moments d’amour furent les plus douloureux. (Oh ! mais j’ai aussi souvenir de bonheurs d’une qualité si rare qu’ils se présentaient sans même être convoqués…)
Je ne pense pas souffrir de trop de déviances. J’ai une imagination banale qui s’étonne parfois de ce qui est vendu en librairie. Sade m’ennuie. Gilles de Rais me terrifie. Je n’aime pas les frasques de Louis XVI et son Parc aux cerfs, les revues… suédoises. Mais, force est de constater, pour paraphraser Frère Friar, dans Roméo et Juliette que :
… Deux tels souverains rivaux [le vice et la vertu] incarnent
Dans l’homme, comme pour les simples, la grâce et la violence ;
Et je ne suis pas sûr d’adopter la fin :
Et là où le pire domine,
Bien vite le chancre dévore la plante.
… car je me rappelle l’innocence de tes traits quelques secondes une fois que tu fus revenue au monde. Et la banalité de nos vies mutuelles ne m’offre, à ce jour, aucune réponse à ces noces tragiques…
mardi 19 mai 2009
Grenelles

Quand dans n’importe quelle entreprise humaine on forme une commission, c’est pour évacuer un point qui, bien que pressant, ne peut trouver une réponse adéquate ; souvent en raison des intérêts contradictoires des parties en présence. Entre le gouvernement et le peuple, cela s’appelle un Grenelle.
Cette morne plaine où les Gaulois se firent battre – pour ne pas changer – par les Romains et qui s’étendait grosso modo des Invalides à Javel, a donné son nom à une série de réunions où, en mai 68, la CGT l’emporta contre le patronat, dans la salle des Accords, au ministère du Travail, rue de Grenelle. Victoire à la Pyrrhus, car le seul résultat qui aboutît aux demandes de transformations sociales réclamées par les Travailleurs (nouvelle hiérarchie, nouvelle gouvernance – qui s’appelait : autorité – nouvelles relations entre l’entreprise et l’Etat, l’école et l’université…) sera une hausse de 35% du SMIG, soit une élévation générale des salaires de 10% et une inflation si intense que tous les avantages consentis furent « bouffés », selon l’expression de Michel Jobert, en six mois et signèrent la perte immédiate de compétitivité de l’industrie française. Il faudra attendre les lois Auroux de 1981 pour voir aboutir une ébauche d’application de ce qui était demandé à l’époque.
Il est donc piquant d’entendre tout un chacun annoncer, réclamer, exiger… à grands renforts de presse, son “Grenelle”, en guise de consultation publique sur un sujet majeur.
Qu’on s’en rende compte, pour le début de notre troisième millénaire, nous eûmes :
* le Grenelle de la santé (2001)
* le Grenelle de l'environnement (octobre 2007)
* le Grenelle de l'insertion (2007)
* le Grenelle de la formation (proposé en 2007 par M. de Villepin)
Et en 2009, 41 ans après Mai 68, une floraison exceptionnelle :
* le Grenelle de l'audiovisuel, (vœu pieu de Madame Albanel…)
* le Grenelle de la mer (Michel Garnier)
* le Grenelle des ondes (François Fillon).
Alors que nous ne sommes même pas encore au milieu de l’année…
Quand on voit les résultats pratiques desdits Grenelle ci-dessus, on est en droit de se dire qu’ils annoncent le même type de catastrophes obtenu en Mai 68 par MM. Séguy (pour la CGT) et Jacques Chirac. Si bien qu’on serait tenté de dire que « Grenelle » est le dernier euphémisme pour : “Circulez ! y a rien à voir.”
Ou : “Casse-toi ! pov’ con…”
lundi 11 mai 2009
Instabilité
“La vie n’est qu’un rêve…” me disait souvent Madame Sirakian, voyante extra lucide. La question que je ne lui posais pas alors – étant trop intéressé par mon avenir – aurait dû être : “Oui, mais le rêve de qui ?” Ce qui, je crois, se trouve dans une réplique d’un film de Cronenberg, avec Naomi Watts ; à moins que cela ne soit Nicolas Cage, ailleurs !… Quoi qu’il en soit, Hamlet avait déjà l’intuition que les rêves n’étaient pas des œuvres très individuelles ; ni particulièrement charitables.
Moi, ce qui m’inquiète c’est le destin qui m’attend une fois franchi ce pas où, apparemment, on devient si indifférent à tout ici-bas que l’on se laisse même bouffer par les asticots. (Pour autant qu’ils veuillent de nous. Car, toujours, si l’on en croit Shakespeare, certains vers se feraient une spécialité de faire des festins de roi ; ce que je ne peux leur offrir, étant donné la modestie de ma condition sociale.)
Ce qui me préoccupe donc, c’est qu’à regarder le parcours qui m’a mené de mes premiers vagissements à cette espèce de total étonnement qui caractérise la vision que j’ai de ma vie… Ce qui me préoccupe, c’est de savoir si je vais pouvoir tenir dans une seule position et dans une seule résidence pour un temps dont on nous dit qu’il risque d’être terriblement long.
Je ne vois, en effet, aucune cohérence dans ma vie qui pourrait décrire mes activités comme stables. J’ai plutôt l’impression d’avoir été une espèce de fret, chahuté d’un bord à l’autre d’un de ces grands bateaux à aubes que l’on voyait jadis sur le Léman, et qui allaient de port en ports, sans jamais y faire escale.
Ce qui veut dire qu’il faudrait que je trouve une raison de vivre, pour mourir en paix. En effet, comment terminer convenablement une chose que l’on a à peine commencée ?
En effet, une fois là-bas, malgré mon caractère casanier, dois cesser mes tergiversations du passé pour trouver cercueil à mon pied. Faute de quoi, je risque d’être condamné à une espèce de perpétuel saute tombeau. Le problème c’est qu’il ne reste plus beaucoup de tombes auxquelles je pourrais rendre visite. (Même celle de Denis, à Concise, et qui aurait mon âge - eût-il survécu à sa maladie - va disparaître, si ce n’est déjà fait…) C’est que, comme dirait Monsieur de la Palisse, plus on est à vivre sur terre, plus il y en a qui meurent !
Je ne vois qu’une issue à ce problème à la fois existentiel et démographique : C’est, juste avant de m’immobiliser dans cet ailleurs aux capacités d’accueil relatives, faire quelque action d’éclat qui me permette de reposer sur mes lauriers ; être amoureux, peut-être ?…
Moi, ce qui m’inquiète c’est le destin qui m’attend une fois franchi ce pas où, apparemment, on devient si indifférent à tout ici-bas que l’on se laisse même bouffer par les asticots. (Pour autant qu’ils veuillent de nous. Car, toujours, si l’on en croit Shakespeare, certains vers se feraient une spécialité de faire des festins de roi ; ce que je ne peux leur offrir, étant donné la modestie de ma condition sociale.)
Ce qui me préoccupe donc, c’est qu’à regarder le parcours qui m’a mené de mes premiers vagissements à cette espèce de total étonnement qui caractérise la vision que j’ai de ma vie… Ce qui me préoccupe, c’est de savoir si je vais pouvoir tenir dans une seule position et dans une seule résidence pour un temps dont on nous dit qu’il risque d’être terriblement long.
Je ne vois, en effet, aucune cohérence dans ma vie qui pourrait décrire mes activités comme stables. J’ai plutôt l’impression d’avoir été une espèce de fret, chahuté d’un bord à l’autre d’un de ces grands bateaux à aubes que l’on voyait jadis sur le Léman, et qui allaient de port en ports, sans jamais y faire escale.
Ce qui veut dire qu’il faudrait que je trouve une raison de vivre, pour mourir en paix. En effet, comment terminer convenablement une chose que l’on a à peine commencée ?
En effet, une fois là-bas, malgré mon caractère casanier, dois cesser mes tergiversations du passé pour trouver cercueil à mon pied. Faute de quoi, je risque d’être condamné à une espèce de perpétuel saute tombeau. Le problème c’est qu’il ne reste plus beaucoup de tombes auxquelles je pourrais rendre visite. (Même celle de Denis, à Concise, et qui aurait mon âge - eût-il survécu à sa maladie - va disparaître, si ce n’est déjà fait…) C’est que, comme dirait Monsieur de la Palisse, plus on est à vivre sur terre, plus il y en a qui meurent !
Je ne vois qu’une issue à ce problème à la fois existentiel et démographique : C’est, juste avant de m’immobiliser dans cet ailleurs aux capacités d’accueil relatives, faire quelque action d’éclat qui me permette de reposer sur mes lauriers ; être amoureux, peut-être ?…
mardi 5 mai 2009
Saint-Honoré
Souvent, le dimanche, le médecin de famille venait déjeuner avec nous. C’était surtout l’été. Et sa visite signait, en quelque sorte, le début des grandes vacances. Nous, les enfants, avions le droit de sortir de table plus tôt, non sans en avoir demandé la permission aux parents et au “gentil” docteur. Et nous revenions pour le dessert qui était souvent un saint-honoré. Ah ! ces saint-honoré des repas dominicaux. Combien d’ailleurs ne furent-il pas le cas d’indigestions, de crise de foie nous envoyant droit au lit avec une tisane en sautant le souper…
C’est qu’à l’époque, on montait la chantilly avec du blanc d’œuf. Et le frigidaire n’ayant pas encore remplacé la glacière, le risque d’empoisonnement botulique n’était pas exclu pour peu que l’on attendît un peu de consommer ce roi des desserts. Un empoisonnement qui parfois décimait une faille entière, médecin de famille compris ; s’il avait le malheur d’être de la fête ce jour-là.
Mais cette prise de risque professionnelle faisait partie des choses de la vie : repas trop lourds, empoisonnements au bacille botulique ou à l’excès de sulfite d’un Chablis ou d’un gewürztraminer, étaient souvent le prix à payer pour tout médecin de famille qui se respectait. Car c’est au cours de ces repas qu’il pouvait voir si “la cadette” qu’il avait aidée à naître six ans auparavant, avait une petite mine, ou si l’épouse, dont il connaissait la vie intime comme un roman de Flaubert, se portait bien et si le mari soignait sa tension… Tout ce joli monde se retrouvait les semaines suivantes dans son cabinet. Et le médecin soignait, encourageait, mettait à jour ses notes sur le parcours médical de chacun, décelait les premières attaques de la maladie dans les corps qu’il auscultait avec l’attention et la précision du mécanicien qui réglait le carburateur de sa Hotchkiss ou de sa Panhard grand sport…
Quand il ne pouvait identifier ce qu’il ressentait au bout de ses doigts ou entendait au stéthoscope, il faisait appel à un “Cher Confrère”. Un professeur de renom de la Faculté, un prestigieux chef de service à l’Hôpital…
La médecine n’était pas très difficile si l’on aimait les gens, pour peu qu’on ait une bonne mémoire. Elle n’était pas très efficace, non plus. Mais elle sauvait – et pas seulement les corps – à coups de tisanes, de longs repos, de bon air et du produit de quelques fioles qu’on trouvait aussi, assez souvent, dans la cuisine…
L’objet ici n’est pas de regretter cette époque où il y avait encore des cuisinières à passer suffisamment de temps pour faire un saint-honoré et où l’on payait son médecin une fois l’an, quand il pensait à vous envoyer sa note d’honoraires. Et bien que cette vision un peu trop idyllique ne fut pas nécessairement la règle, l’usage voulait que le médecin de famille, celui du dispensaire, ou celui du quartier, du village… par ses incessantes visites, par le temps qu’il prenait pour établir un diagnostic, constituait souvent la mémoire vivante et ambulante, de la vie d’un homme, qu’il accompagnait dans ses épreuves, souvent jusqu’à sa dernière demeure. Le médecin était un dossier médical qui mangeait, rotait, se fâchait, calmait, conseillait… et – c’était un espoir - sauvait, lorsque c’était en son pouvoir.
Aujourd’hui, la médecine, sous nos latitudes, ne se pratique plus comme cela ; et les risques professionnels sont autrement plus sérieux que le risque d’un empoisonnement au saint-honoré. La science plus précise, même si elle est fragmentaire, est plus efficace. On n’appelle plus – ou rarement – le ponte du service prestigieux de la Salpetrière ou de Cochin, mais on envoie au “Cher Ami” (dont on a trouvé le nom dans l’annuaire) le malade qui se trouve souvent par hasard à sa consultation, faute d’avoir pu trouver chez d’autres médecins, les soins qu’il exige de la Sécurité sociale. On soigne mieux, même s’il arrive, de plus en plus fréquemment, que le traitement tue avant la maladie… Les années 1970 ont marqué, dans les pays industrialisés, l’influence des actions politiques volontaires contre la mort, aussi bien pour le grand âge que pour la petite enfance. C’est le vrai début de l’élaboration de règles de surveillance périnatale pour l’amélioration des conditions d’accouchement. On s’essaie aussi à la réanimation des nouveau-nés en salle de travail et à la création de centres de réanimation néonatale. Vaccination, révision de la législation du travail suivent, en même temps que l’on dégage 60 millions de francs pour la formation du personnel et la rénovation des établissements publics d’accouchement. Les décrets des 21 février 1972 et du 7 août 1975 ont pour conséquence immédiate la fermeture de 325 petites maternités, publiques et privées confondues… Viendront les autres lois de réforme hospitalière de 1990-91, du 4 mars 2002, ainsi que les ordonnances du Plan Juppé, qui ont donné l’élan aux nouvelles structures de soins : Agence régionale d’hospitalisation (ARH) (bientôt, Agences régionales de Santé (ARS)), départements au lieu de services hospitaliers, gouvernance à la place de direction, tarification à l’activité (T2A), plutôt que comptabilité, projet de médicalisation des systèmes de santé (PMSI) en lieu de gestion, et autres acronymes recouvrant des pratiques parallèles, des tutelles, souvent redondantes… Au hasard : CNAMTS, CRAM, CNOSS, ACOSS, URCAM, CPAM, SIS, DIM, SIH, UCANSS, AMELI, CEPTE et TEE, devenant TESE, Afssaps, HAS (Ha ! ah !), CREM…
Vous avez dit CREM ? Avec le saint-honoré relégué au rang des accessoires inutiles, reste à trouver une façon pour le médecin de se repérer dans cette jungle où il guide son patient (somme toute, son fonds de commerce), cerné qu’il est pas les empêcheurs de soigner en rond et autres organismes de tutelle. Et l’on ne parle pas des progrès médicaux (2000 publications par mois) qui assaillent sa pratique, mais qui ne l’aident pas dans sa lutte contre les feux de fesses, les divers patraqueries des malades illuminés ou graves ; et les arrêts maladie ou LE Scanner – c’est bien le moins - que tout assuré social revendique comme un droit inaliénable. Dame ! c’est que le droit à la Santé est inscrit au protocole de notre constitution…
La médecine est devenue un travail d’équipe ; des réseaux de Chers Amis qui ne se connaissent pas et se respectent à peine quand ils ne se jalousent pas.
Nouvelle époque, nouveau paradigme, la bienveillante Tutelle entend, grâce aux progrès de l’informatique établir une nouvelle façon de pratiquer la médecine dont le prototype s’appelle : Dossier médical personnel (DMP). C’est-à-dire, un bidule qui réduit l’expérience de feu le médecin de famille à la taille d’une puce ou d’une clef USB… Plus fiable, parce qu’éternellement jeune et disposant de capacités de mémoire inégalées et des possibilités de synthèses supérieures à nous, simples mortels… enfin, pour ce dernier point, on espère !…
Et c’est ainsi que l’Office parlementaire d’Evaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), s’est réuni en audience publique, la semaine dernière, sous la présidence de Monsieur Pierre Lasbordes, député de l’Essonne, pour faire le point sur cet outil qui bénéficie d’un soudain retour d’amour de la part de la Tutelle.
Il fallut notamment résoudre le problème que posait l’identité du « P » de DMP : Car « P » veut-il vraiment dire : « personnel », c’est-à-dire propre au patient – et donc, en quels termes : juridiques, administratifs, médicaux ?…. Ou est-ce aussi le « P » de partager, (les données médicales, par exemples) et subséquemment, selon quels critères nosographiques ? Ou est-ce le « P » de professionnel : mais alors, quelle profession tiendra la dragée haute à toutes celles que créent annuellement la science médicale, la chimie, l’industrie et l'intarissable imagination politique et syndicale ?
On se quitta sans y répondre ; même si du point de vue philosophique, “personnel” fut retenu, vu les moult séances à l’Assemblée nationale qui furent nécessaires à son choix.
Reste que le GIP, bientôt le ZIP DMP, bien que ballotté entre les ministres se succédant à la Santé, entre législatives, municipales, européennes, ou régionales… fonctionne - chose étonnante, en cette période de crise – à fonds perdus. Son objet médical interdit que l’on parle de retours sur investissements autres que l’amélioration de la qualité des soins. Le seul progrès indubitable – et ce, malgré des expériences régionales intéressante - c’est qu’au bout des quelques dix années qui nous séparent des premiers balbutiements du plan stratégique de Gilles Johanet, directeur de la CNAMTS (1989-1993/1998-2002), et qui s’inspirait notamment du projet avorté de Jacques Barrot, en 1996, du Carnet de santé, c’est d’être enfin arrivé à définir un identifiant pour chaque malade. (Merci la CNIL !) Il s’agit d’un numéro (NIS)… aléatoire.
Et pas le moindre gâteau sec pour agrémenter les discussions…
C’est qu’à l’époque, on montait la chantilly avec du blanc d’œuf. Et le frigidaire n’ayant pas encore remplacé la glacière, le risque d’empoisonnement botulique n’était pas exclu pour peu que l’on attendît un peu de consommer ce roi des desserts. Un empoisonnement qui parfois décimait une faille entière, médecin de famille compris ; s’il avait le malheur d’être de la fête ce jour-là.
Mais cette prise de risque professionnelle faisait partie des choses de la vie : repas trop lourds, empoisonnements au bacille botulique ou à l’excès de sulfite d’un Chablis ou d’un gewürztraminer, étaient souvent le prix à payer pour tout médecin de famille qui se respectait. Car c’est au cours de ces repas qu’il pouvait voir si “la cadette” qu’il avait aidée à naître six ans auparavant, avait une petite mine, ou si l’épouse, dont il connaissait la vie intime comme un roman de Flaubert, se portait bien et si le mari soignait sa tension… Tout ce joli monde se retrouvait les semaines suivantes dans son cabinet. Et le médecin soignait, encourageait, mettait à jour ses notes sur le parcours médical de chacun, décelait les premières attaques de la maladie dans les corps qu’il auscultait avec l’attention et la précision du mécanicien qui réglait le carburateur de sa Hotchkiss ou de sa Panhard grand sport…
Quand il ne pouvait identifier ce qu’il ressentait au bout de ses doigts ou entendait au stéthoscope, il faisait appel à un “Cher Confrère”. Un professeur de renom de la Faculté, un prestigieux chef de service à l’Hôpital…
La médecine n’était pas très difficile si l’on aimait les gens, pour peu qu’on ait une bonne mémoire. Elle n’était pas très efficace, non plus. Mais elle sauvait – et pas seulement les corps – à coups de tisanes, de longs repos, de bon air et du produit de quelques fioles qu’on trouvait aussi, assez souvent, dans la cuisine…
L’objet ici n’est pas de regretter cette époque où il y avait encore des cuisinières à passer suffisamment de temps pour faire un saint-honoré et où l’on payait son médecin une fois l’an, quand il pensait à vous envoyer sa note d’honoraires. Et bien que cette vision un peu trop idyllique ne fut pas nécessairement la règle, l’usage voulait que le médecin de famille, celui du dispensaire, ou celui du quartier, du village… par ses incessantes visites, par le temps qu’il prenait pour établir un diagnostic, constituait souvent la mémoire vivante et ambulante, de la vie d’un homme, qu’il accompagnait dans ses épreuves, souvent jusqu’à sa dernière demeure. Le médecin était un dossier médical qui mangeait, rotait, se fâchait, calmait, conseillait… et – c’était un espoir - sauvait, lorsque c’était en son pouvoir.
Aujourd’hui, la médecine, sous nos latitudes, ne se pratique plus comme cela ; et les risques professionnels sont autrement plus sérieux que le risque d’un empoisonnement au saint-honoré. La science plus précise, même si elle est fragmentaire, est plus efficace. On n’appelle plus – ou rarement – le ponte du service prestigieux de la Salpetrière ou de Cochin, mais on envoie au “Cher Ami” (dont on a trouvé le nom dans l’annuaire) le malade qui se trouve souvent par hasard à sa consultation, faute d’avoir pu trouver chez d’autres médecins, les soins qu’il exige de la Sécurité sociale. On soigne mieux, même s’il arrive, de plus en plus fréquemment, que le traitement tue avant la maladie… Les années 1970 ont marqué, dans les pays industrialisés, l’influence des actions politiques volontaires contre la mort, aussi bien pour le grand âge que pour la petite enfance. C’est le vrai début de l’élaboration de règles de surveillance périnatale pour l’amélioration des conditions d’accouchement. On s’essaie aussi à la réanimation des nouveau-nés en salle de travail et à la création de centres de réanimation néonatale. Vaccination, révision de la législation du travail suivent, en même temps que l’on dégage 60 millions de francs pour la formation du personnel et la rénovation des établissements publics d’accouchement. Les décrets des 21 février 1972 et du 7 août 1975 ont pour conséquence immédiate la fermeture de 325 petites maternités, publiques et privées confondues… Viendront les autres lois de réforme hospitalière de 1990-91, du 4 mars 2002, ainsi que les ordonnances du Plan Juppé, qui ont donné l’élan aux nouvelles structures de soins : Agence régionale d’hospitalisation (ARH) (bientôt, Agences régionales de Santé (ARS)), départements au lieu de services hospitaliers, gouvernance à la place de direction, tarification à l’activité (T2A), plutôt que comptabilité, projet de médicalisation des systèmes de santé (PMSI) en lieu de gestion, et autres acronymes recouvrant des pratiques parallèles, des tutelles, souvent redondantes… Au hasard : CNAMTS, CRAM, CNOSS, ACOSS, URCAM, CPAM, SIS, DIM, SIH, UCANSS, AMELI, CEPTE et TEE, devenant TESE, Afssaps, HAS (Ha ! ah !), CREM…
Vous avez dit CREM ? Avec le saint-honoré relégué au rang des accessoires inutiles, reste à trouver une façon pour le médecin de se repérer dans cette jungle où il guide son patient (somme toute, son fonds de commerce), cerné qu’il est pas les empêcheurs de soigner en rond et autres organismes de tutelle. Et l’on ne parle pas des progrès médicaux (2000 publications par mois) qui assaillent sa pratique, mais qui ne l’aident pas dans sa lutte contre les feux de fesses, les divers patraqueries des malades illuminés ou graves ; et les arrêts maladie ou LE Scanner – c’est bien le moins - que tout assuré social revendique comme un droit inaliénable. Dame ! c’est que le droit à la Santé est inscrit au protocole de notre constitution…
La médecine est devenue un travail d’équipe ; des réseaux de Chers Amis qui ne se connaissent pas et se respectent à peine quand ils ne se jalousent pas.
Nouvelle époque, nouveau paradigme, la bienveillante Tutelle entend, grâce aux progrès de l’informatique établir une nouvelle façon de pratiquer la médecine dont le prototype s’appelle : Dossier médical personnel (DMP). C’est-à-dire, un bidule qui réduit l’expérience de feu le médecin de famille à la taille d’une puce ou d’une clef USB… Plus fiable, parce qu’éternellement jeune et disposant de capacités de mémoire inégalées et des possibilités de synthèses supérieures à nous, simples mortels… enfin, pour ce dernier point, on espère !…
Et c’est ainsi que l’Office parlementaire d’Evaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), s’est réuni en audience publique, la semaine dernière, sous la présidence de Monsieur Pierre Lasbordes, député de l’Essonne, pour faire le point sur cet outil qui bénéficie d’un soudain retour d’amour de la part de la Tutelle.
Il fallut notamment résoudre le problème que posait l’identité du « P » de DMP : Car « P » veut-il vraiment dire : « personnel », c’est-à-dire propre au patient – et donc, en quels termes : juridiques, administratifs, médicaux ?…. Ou est-ce aussi le « P » de partager, (les données médicales, par exemples) et subséquemment, selon quels critères nosographiques ? Ou est-ce le « P » de professionnel : mais alors, quelle profession tiendra la dragée haute à toutes celles que créent annuellement la science médicale, la chimie, l’industrie et l'intarissable imagination politique et syndicale ?
On se quitta sans y répondre ; même si du point de vue philosophique, “personnel” fut retenu, vu les moult séances à l’Assemblée nationale qui furent nécessaires à son choix.
Reste que le GIP, bientôt le ZIP DMP, bien que ballotté entre les ministres se succédant à la Santé, entre législatives, municipales, européennes, ou régionales… fonctionne - chose étonnante, en cette période de crise – à fonds perdus. Son objet médical interdit que l’on parle de retours sur investissements autres que l’amélioration de la qualité des soins. Le seul progrès indubitable – et ce, malgré des expériences régionales intéressante - c’est qu’au bout des quelques dix années qui nous séparent des premiers balbutiements du plan stratégique de Gilles Johanet, directeur de la CNAMTS (1989-1993/1998-2002), et qui s’inspirait notamment du projet avorté de Jacques Barrot, en 1996, du Carnet de santé, c’est d’être enfin arrivé à définir un identifiant pour chaque malade. (Merci la CNIL !) Il s’agit d’un numéro (NIS)… aléatoire.
Et pas le moindre gâteau sec pour agrémenter les discussions…
lundi 27 avril 2009
Cœur
A un symptôme que l’on m’avait diagnostiqué on m’a demandé : Que ressentez-vous ? J’ai répondu : Un certain état de fébrilité. C’est-à-dire ? Eh ! bien, docteur, rappelez-vous de ce que disait Gide à propos de l’amour : “le meilleur moment, c’est quand on monte l’escalier…” C’est ainsi que je me sens en ce moment. Et Gide n’y est pas pour grand’ chose, mais une certaine de mes connaissances, oui !
Il m’a regardé avec commisération… et m’a placé entre les mains d’un autre homme de l’Art qui m’a aussitôt déclaré moribond. Comme je ne voulais pas suivre ses conseils (une hospitalisation en urgence), il m’a rejeté dans mes immondices, avec le dédain propre aux êtres supérieurs qui suivent le chemin tout tracé de la Science.
Et pourtant, combien de temps cela faisait-il que je n’avais pas ressenti cette petite boule au fond de ma gorge et l’animal qui s’accélère dans ma poitrine alors que, comme le disait Polyeucte : “le désir s’accroît, quand l’effet se recule” …
Ces fesses qui dans le soir
Dessinent comme un espoir… pour paraphraser Bécaut !
Noyant mes symptômes dans le whisky, j’ai consulté un autre homme de l’art, après l’avoir soigneusement choisi pour ses connaissances littéraires aussi bien que médicales. Le bon bougre me déclara apte à la vie. Foi de cardiogramme, intérêt et principal.
(Sauf, bien entendu, dans le cas où, les petits cochons me mangeraient. Et il est vrai qu’en ce moment, du côté du Mexique…)
Cette histoire n’aurait pas d’intérêt si elle n’avait évoqué en moi cette sensation qui soutient les élans de mon cœur, plus souvent que de coutume - surtout quand nous montions l’escalier - et qui fut réduite à l’état de symptôme par des savants sans savoir.
Aujourd’hui, mon cœur et moi, battons la semelle sur le pavé aux aguets de cet instant qui n’est pas encore de l’essoufflement, ni, tout de suite la petite mort ; cet instant contre lequel nulle médecine n’a de prise. A part toi, mon amour. N’en déplaise à la Sécurité sociale…
Il m’a regardé avec commisération… et m’a placé entre les mains d’un autre homme de l’Art qui m’a aussitôt déclaré moribond. Comme je ne voulais pas suivre ses conseils (une hospitalisation en urgence), il m’a rejeté dans mes immondices, avec le dédain propre aux êtres supérieurs qui suivent le chemin tout tracé de la Science.
Et pourtant, combien de temps cela faisait-il que je n’avais pas ressenti cette petite boule au fond de ma gorge et l’animal qui s’accélère dans ma poitrine alors que, comme le disait Polyeucte : “le désir s’accroît, quand l’effet se recule” …
Ces fesses qui dans le soir
Dessinent comme un espoir… pour paraphraser Bécaut !
Noyant mes symptômes dans le whisky, j’ai consulté un autre homme de l’art, après l’avoir soigneusement choisi pour ses connaissances littéraires aussi bien que médicales. Le bon bougre me déclara apte à la vie. Foi de cardiogramme, intérêt et principal.
(Sauf, bien entendu, dans le cas où, les petits cochons me mangeraient. Et il est vrai qu’en ce moment, du côté du Mexique…)
Cette histoire n’aurait pas d’intérêt si elle n’avait évoqué en moi cette sensation qui soutient les élans de mon cœur, plus souvent que de coutume - surtout quand nous montions l’escalier - et qui fut réduite à l’état de symptôme par des savants sans savoir.
Aujourd’hui, mon cœur et moi, battons la semelle sur le pavé aux aguets de cet instant qui n’est pas encore de l’essoufflement, ni, tout de suite la petite mort ; cet instant contre lequel nulle médecine n’a de prise. A part toi, mon amour. N’en déplaise à la Sécurité sociale…
lundi 20 avril 2009
Marilyn
C’était en 1974. Nous étions deux journalistes. La fine fleur de la presse du Cap. Nous parcourions, dans une vieille guimbarde, le sud de la France pour trouver une maison. Nous allions vivre de notre plume : correspondant pour l’Afrique australe en Europe et auteur à succès d’une série de polars, il ne nous manquait que de nous installer.
A Cannes, nous nous étions arrêtés pour prendre un pan bagnat avant que de reprendre la route vers l’Hérault où nous élu domicile dans une ruine appartenant à ma sœur et son mari. En sortant de Cannes, j’aperçu un panneau : le xème festival de Cannes vous remercie de votre visite. En dessous les dates dudit festival. Il restait deux jours de festivité. Je dis à Theo ce qu’il en était et nous retournâmes en ville où nous nous accréditâmes pour suivre les derniers jours de la manifestation.
Il ne restait que des strapontins. Tout ce qui était intéressant était passé. Il ne manquait plus que la dernière réception pour laquelle nos qualifications ne convenaient pas. Mais on nous laissa rentrer dans le Palais du festival et nous engageâmes la conversation avec qui il restait, avides de voir un film gratuit, piqués par la possibilité d’envoyer un papier à Brian Barrow qui était alors, l’éditeur des pages Arts du Cape Times.
Il ne restait à voir que : Derrière la chambre verte.
L’attaché de presse nous dit que nous avions une chance incroyable. C’était la première fois qu’un film X était présenté à Cannes et que l’actrice, Marilyn Chambers, était formidable. Vous n’en croirez pas vos yeux ! Et il nous donna deux places pour le soir même.
Et, en effet, tout le long d’un scénario riquiqui, l’actrice, une jolie jeune fille (elle devait avoir 22 ans), se faisait asperger par tous les bouts dont l’un était noir, l’autre roux, ou encore un gros rose… Elle en avait partout – même dans les cheveux, je crois me souvenir – et elle lapait ceci de la façon la plus ahurissante pour les pères de famille que Theo et moi étions, et dont l’expertise en la matière s’arrêtait à la Fille du mois dans Playboy… Et encore ! pas tous les mois…
Le lendemain, nous arrivâmes comme convenu sur la plage du Martinez où Marilyn nous attendait avec son mari, vers neuf heures du matin – très professionnel ! Je la prenais en photos sous toutes les coutures - elle avait un bikini fuscia – tandis que Theo l’interviewais.
De retour à Arboras, notre repaire, je développai le film dans des conditions de confort dignes des tranchées de la guerre du Vietnam et envoyai les images, avec l’article de Theo, à Brian qui publia le tout dans l’édition du Week-end suivant : pleine page, 9 colonnes à la une. (Eh ! oui, le Cape Times était imprimé sur neuf colonnes.) La gloire !
Notre carrière de grands reporters se confirmait.
Bientôt nous trouvâmes la maison où nous pourrions vivre respectivement avec nos femmes et, pour chacun, nos deux petites filles, et couler des jours heureux entre machines à écrire et voyages pour le compte des titres les plus prestigieux…
Marilyn est morte la semaine dernière. Theo, je ne sais pas ce qu’il est devenu. Johnny Keyes, le partenaire noir de Marilyn n’est peut-être plus en vie. Mais je me rappelle cette partie de son anatomie, la seule qui apparaissait à l’écran, et l’obsession qu’elle provoqua chez Theo.
En effet, après Cannes, Theo répéta à presque tous les tournants d’une route pourtant très sinueuse : Ach sis ! mann ; Those poor little girls. Ces pauvres petites filles, c’étaient les siennes. Theo réalisait qu’en quittant le pays de l’Apartheid pour l’Europe des Lumières (passons vite sur ce terme conventionnel !) il exposait sa descendance à un sort plus terrible que la mort ! (Worst than death !) Et le membre de Johnny Keyes hanta ses jours et ses nuits tout le reste de son séjour en France. (Peut-être se réveille-t-il encore la nuit, en nage, s’il vit encore ?) Et l’image du visage si pur de Marilyn, subissant les immondes assauts, venait se plaquer sur les angéliques têtes blondes de ses enfants ; la prunelle de ses yeux…
Theo, une fois l’article rédigé, entra bientôt dans un état cataleptique. Je l’installai comme je pus dans les ruines que nous avions finalement achetées pour notre projet. Dans un deckchair 1900, où Madame Arboux lui apportait tomates et salades – le pôvre ! Il ressemblait à ce tableau de Byron mourant ou Sardanapale - sans le massacre de ses maîtresses, mais avec cette cruauté désespérée dans le regard que Delacroix a peinte… Il ne se laissait non pas mourir, mais aller pour que l’on se charge de lui ; qu’on l’emmène loin de cette civilisation immonde où le sperme d’un nègre était blanc…
On le rapatria à la condition qu’une fois de retour, il ne quitterait plus l’Afrique du Sud.
En apprenant la mort de Marilyn Chambers, d’abord le nom ne m’évoqua rien. Et puis, très vite, quand même, je me souvins.
Je me souviens surtout de l’innocence du charmant visage de l’actrice américaine. C’était une de ces jeunes filles, comme j’en avais connues à Abington Senior High, et que j’aurais été heureux de sortir ; fier de présenter à mes amis, à ma famille. L’épouser, peut-être…
Pour le reste, bien sûr, pour ce qui est de ce que nous avions vu, Theo et moi, eh ! bien, comme pour chacun de nous, il suffit de pousser la porte de la chambre verte…
Ach Sis ! Mann ! Poor little girl…
A Cannes, nous nous étions arrêtés pour prendre un pan bagnat avant que de reprendre la route vers l’Hérault où nous élu domicile dans une ruine appartenant à ma sœur et son mari. En sortant de Cannes, j’aperçu un panneau : le xème festival de Cannes vous remercie de votre visite. En dessous les dates dudit festival. Il restait deux jours de festivité. Je dis à Theo ce qu’il en était et nous retournâmes en ville où nous nous accréditâmes pour suivre les derniers jours de la manifestation.
Il ne restait que des strapontins. Tout ce qui était intéressant était passé. Il ne manquait plus que la dernière réception pour laquelle nos qualifications ne convenaient pas. Mais on nous laissa rentrer dans le Palais du festival et nous engageâmes la conversation avec qui il restait, avides de voir un film gratuit, piqués par la possibilité d’envoyer un papier à Brian Barrow qui était alors, l’éditeur des pages Arts du Cape Times.
Il ne restait à voir que : Derrière la chambre verte.
L’attaché de presse nous dit que nous avions une chance incroyable. C’était la première fois qu’un film X était présenté à Cannes et que l’actrice, Marilyn Chambers, était formidable. Vous n’en croirez pas vos yeux ! Et il nous donna deux places pour le soir même.
Et, en effet, tout le long d’un scénario riquiqui, l’actrice, une jolie jeune fille (elle devait avoir 22 ans), se faisait asperger par tous les bouts dont l’un était noir, l’autre roux, ou encore un gros rose… Elle en avait partout – même dans les cheveux, je crois me souvenir – et elle lapait ceci de la façon la plus ahurissante pour les pères de famille que Theo et moi étions, et dont l’expertise en la matière s’arrêtait à la Fille du mois dans Playboy… Et encore ! pas tous les mois…
Le lendemain, nous arrivâmes comme convenu sur la plage du Martinez où Marilyn nous attendait avec son mari, vers neuf heures du matin – très professionnel ! Je la prenais en photos sous toutes les coutures - elle avait un bikini fuscia – tandis que Theo l’interviewais.
De retour à Arboras, notre repaire, je développai le film dans des conditions de confort dignes des tranchées de la guerre du Vietnam et envoyai les images, avec l’article de Theo, à Brian qui publia le tout dans l’édition du Week-end suivant : pleine page, 9 colonnes à la une. (Eh ! oui, le Cape Times était imprimé sur neuf colonnes.) La gloire !
Notre carrière de grands reporters se confirmait.
Bientôt nous trouvâmes la maison où nous pourrions vivre respectivement avec nos femmes et, pour chacun, nos deux petites filles, et couler des jours heureux entre machines à écrire et voyages pour le compte des titres les plus prestigieux…
Marilyn est morte la semaine dernière. Theo, je ne sais pas ce qu’il est devenu. Johnny Keyes, le partenaire noir de Marilyn n’est peut-être plus en vie. Mais je me rappelle cette partie de son anatomie, la seule qui apparaissait à l’écran, et l’obsession qu’elle provoqua chez Theo.
En effet, après Cannes, Theo répéta à presque tous les tournants d’une route pourtant très sinueuse : Ach sis ! mann ; Those poor little girls. Ces pauvres petites filles, c’étaient les siennes. Theo réalisait qu’en quittant le pays de l’Apartheid pour l’Europe des Lumières (passons vite sur ce terme conventionnel !) il exposait sa descendance à un sort plus terrible que la mort ! (Worst than death !) Et le membre de Johnny Keyes hanta ses jours et ses nuits tout le reste de son séjour en France. (Peut-être se réveille-t-il encore la nuit, en nage, s’il vit encore ?) Et l’image du visage si pur de Marilyn, subissant les immondes assauts, venait se plaquer sur les angéliques têtes blondes de ses enfants ; la prunelle de ses yeux…
Theo, une fois l’article rédigé, entra bientôt dans un état cataleptique. Je l’installai comme je pus dans les ruines que nous avions finalement achetées pour notre projet. Dans un deckchair 1900, où Madame Arboux lui apportait tomates et salades – le pôvre ! Il ressemblait à ce tableau de Byron mourant ou Sardanapale - sans le massacre de ses maîtresses, mais avec cette cruauté désespérée dans le regard que Delacroix a peinte… Il ne se laissait non pas mourir, mais aller pour que l’on se charge de lui ; qu’on l’emmène loin de cette civilisation immonde où le sperme d’un nègre était blanc…
On le rapatria à la condition qu’une fois de retour, il ne quitterait plus l’Afrique du Sud.
En apprenant la mort de Marilyn Chambers, d’abord le nom ne m’évoqua rien. Et puis, très vite, quand même, je me souvins.
Je me souviens surtout de l’innocence du charmant visage de l’actrice américaine. C’était une de ces jeunes filles, comme j’en avais connues à Abington Senior High, et que j’aurais été heureux de sortir ; fier de présenter à mes amis, à ma famille. L’épouser, peut-être…
Pour le reste, bien sûr, pour ce qui est de ce que nous avions vu, Theo et moi, eh ! bien, comme pour chacun de nous, il suffit de pousser la porte de la chambre verte…
Ach Sis ! Mann ! Poor little girl…
Inscription à :
Articles (Atom)