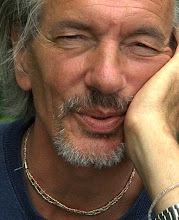A un symptôme que l’on m’avait diagnostiqué on m’a demandé : Que ressentez-vous ? J’ai répondu : Un certain état de fébrilité. C’est-à-dire ? Eh ! bien, docteur, rappelez-vous de ce que disait Gide à propos de l’amour : “le meilleur moment, c’est quand on monte l’escalier…” C’est ainsi que je me sens en ce moment. Et Gide n’y est pas pour grand’ chose, mais une certaine de mes connaissances, oui !
Il m’a regardé avec commisération… et m’a placé entre les mains d’un autre homme de l’Art qui m’a aussitôt déclaré moribond. Comme je ne voulais pas suivre ses conseils (une hospitalisation en urgence), il m’a rejeté dans mes immondices, avec le dédain propre aux êtres supérieurs qui suivent le chemin tout tracé de la Science.
Et pourtant, combien de temps cela faisait-il que je n’avais pas ressenti cette petite boule au fond de ma gorge et l’animal qui s’accélère dans ma poitrine alors que, comme le disait Polyeucte : “le désir s’accroît, quand l’effet se recule” …
Ces fesses qui dans le soir
Dessinent comme un espoir… pour paraphraser Bécaut !
Noyant mes symptômes dans le whisky, j’ai consulté un autre homme de l’art, après l’avoir soigneusement choisi pour ses connaissances littéraires aussi bien que médicales. Le bon bougre me déclara apte à la vie. Foi de cardiogramme, intérêt et principal.
(Sauf, bien entendu, dans le cas où, les petits cochons me mangeraient. Et il est vrai qu’en ce moment, du côté du Mexique…)
Cette histoire n’aurait pas d’intérêt si elle n’avait évoqué en moi cette sensation qui soutient les élans de mon cœur, plus souvent que de coutume - surtout quand nous montions l’escalier - et qui fut réduite à l’état de symptôme par des savants sans savoir.
Aujourd’hui, mon cœur et moi, battons la semelle sur le pavé aux aguets de cet instant qui n’est pas encore de l’essoufflement, ni, tout de suite la petite mort ; cet instant contre lequel nulle médecine n’a de prise. A part toi, mon amour. N’en déplaise à la Sécurité sociale…
lundi 27 avril 2009
lundi 20 avril 2009
Marilyn
C’était en 1974. Nous étions deux journalistes. La fine fleur de la presse du Cap. Nous parcourions, dans une vieille guimbarde, le sud de la France pour trouver une maison. Nous allions vivre de notre plume : correspondant pour l’Afrique australe en Europe et auteur à succès d’une série de polars, il ne nous manquait que de nous installer.
A Cannes, nous nous étions arrêtés pour prendre un pan bagnat avant que de reprendre la route vers l’Hérault où nous élu domicile dans une ruine appartenant à ma sœur et son mari. En sortant de Cannes, j’aperçu un panneau : le xème festival de Cannes vous remercie de votre visite. En dessous les dates dudit festival. Il restait deux jours de festivité. Je dis à Theo ce qu’il en était et nous retournâmes en ville où nous nous accréditâmes pour suivre les derniers jours de la manifestation.
Il ne restait que des strapontins. Tout ce qui était intéressant était passé. Il ne manquait plus que la dernière réception pour laquelle nos qualifications ne convenaient pas. Mais on nous laissa rentrer dans le Palais du festival et nous engageâmes la conversation avec qui il restait, avides de voir un film gratuit, piqués par la possibilité d’envoyer un papier à Brian Barrow qui était alors, l’éditeur des pages Arts du Cape Times.
Il ne restait à voir que : Derrière la chambre verte.
L’attaché de presse nous dit que nous avions une chance incroyable. C’était la première fois qu’un film X était présenté à Cannes et que l’actrice, Marilyn Chambers, était formidable. Vous n’en croirez pas vos yeux ! Et il nous donna deux places pour le soir même.
Et, en effet, tout le long d’un scénario riquiqui, l’actrice, une jolie jeune fille (elle devait avoir 22 ans), se faisait asperger par tous les bouts dont l’un était noir, l’autre roux, ou encore un gros rose… Elle en avait partout – même dans les cheveux, je crois me souvenir – et elle lapait ceci de la façon la plus ahurissante pour les pères de famille que Theo et moi étions, et dont l’expertise en la matière s’arrêtait à la Fille du mois dans Playboy… Et encore ! pas tous les mois…
Le lendemain, nous arrivâmes comme convenu sur la plage du Martinez où Marilyn nous attendait avec son mari, vers neuf heures du matin – très professionnel ! Je la prenais en photos sous toutes les coutures - elle avait un bikini fuscia – tandis que Theo l’interviewais.
De retour à Arboras, notre repaire, je développai le film dans des conditions de confort dignes des tranchées de la guerre du Vietnam et envoyai les images, avec l’article de Theo, à Brian qui publia le tout dans l’édition du Week-end suivant : pleine page, 9 colonnes à la une. (Eh ! oui, le Cape Times était imprimé sur neuf colonnes.) La gloire !
Notre carrière de grands reporters se confirmait.
Bientôt nous trouvâmes la maison où nous pourrions vivre respectivement avec nos femmes et, pour chacun, nos deux petites filles, et couler des jours heureux entre machines à écrire et voyages pour le compte des titres les plus prestigieux…
Marilyn est morte la semaine dernière. Theo, je ne sais pas ce qu’il est devenu. Johnny Keyes, le partenaire noir de Marilyn n’est peut-être plus en vie. Mais je me rappelle cette partie de son anatomie, la seule qui apparaissait à l’écran, et l’obsession qu’elle provoqua chez Theo.
En effet, après Cannes, Theo répéta à presque tous les tournants d’une route pourtant très sinueuse : Ach sis ! mann ; Those poor little girls. Ces pauvres petites filles, c’étaient les siennes. Theo réalisait qu’en quittant le pays de l’Apartheid pour l’Europe des Lumières (passons vite sur ce terme conventionnel !) il exposait sa descendance à un sort plus terrible que la mort ! (Worst than death !) Et le membre de Johnny Keyes hanta ses jours et ses nuits tout le reste de son séjour en France. (Peut-être se réveille-t-il encore la nuit, en nage, s’il vit encore ?) Et l’image du visage si pur de Marilyn, subissant les immondes assauts, venait se plaquer sur les angéliques têtes blondes de ses enfants ; la prunelle de ses yeux…
Theo, une fois l’article rédigé, entra bientôt dans un état cataleptique. Je l’installai comme je pus dans les ruines que nous avions finalement achetées pour notre projet. Dans un deckchair 1900, où Madame Arboux lui apportait tomates et salades – le pôvre ! Il ressemblait à ce tableau de Byron mourant ou Sardanapale - sans le massacre de ses maîtresses, mais avec cette cruauté désespérée dans le regard que Delacroix a peinte… Il ne se laissait non pas mourir, mais aller pour que l’on se charge de lui ; qu’on l’emmène loin de cette civilisation immonde où le sperme d’un nègre était blanc…
On le rapatria à la condition qu’une fois de retour, il ne quitterait plus l’Afrique du Sud.
En apprenant la mort de Marilyn Chambers, d’abord le nom ne m’évoqua rien. Et puis, très vite, quand même, je me souvins.
Je me souviens surtout de l’innocence du charmant visage de l’actrice américaine. C’était une de ces jeunes filles, comme j’en avais connues à Abington Senior High, et que j’aurais été heureux de sortir ; fier de présenter à mes amis, à ma famille. L’épouser, peut-être…
Pour le reste, bien sûr, pour ce qui est de ce que nous avions vu, Theo et moi, eh ! bien, comme pour chacun de nous, il suffit de pousser la porte de la chambre verte…
Ach Sis ! Mann ! Poor little girl…
A Cannes, nous nous étions arrêtés pour prendre un pan bagnat avant que de reprendre la route vers l’Hérault où nous élu domicile dans une ruine appartenant à ma sœur et son mari. En sortant de Cannes, j’aperçu un panneau : le xème festival de Cannes vous remercie de votre visite. En dessous les dates dudit festival. Il restait deux jours de festivité. Je dis à Theo ce qu’il en était et nous retournâmes en ville où nous nous accréditâmes pour suivre les derniers jours de la manifestation.
Il ne restait que des strapontins. Tout ce qui était intéressant était passé. Il ne manquait plus que la dernière réception pour laquelle nos qualifications ne convenaient pas. Mais on nous laissa rentrer dans le Palais du festival et nous engageâmes la conversation avec qui il restait, avides de voir un film gratuit, piqués par la possibilité d’envoyer un papier à Brian Barrow qui était alors, l’éditeur des pages Arts du Cape Times.
Il ne restait à voir que : Derrière la chambre verte.
L’attaché de presse nous dit que nous avions une chance incroyable. C’était la première fois qu’un film X était présenté à Cannes et que l’actrice, Marilyn Chambers, était formidable. Vous n’en croirez pas vos yeux ! Et il nous donna deux places pour le soir même.
Et, en effet, tout le long d’un scénario riquiqui, l’actrice, une jolie jeune fille (elle devait avoir 22 ans), se faisait asperger par tous les bouts dont l’un était noir, l’autre roux, ou encore un gros rose… Elle en avait partout – même dans les cheveux, je crois me souvenir – et elle lapait ceci de la façon la plus ahurissante pour les pères de famille que Theo et moi étions, et dont l’expertise en la matière s’arrêtait à la Fille du mois dans Playboy… Et encore ! pas tous les mois…
Le lendemain, nous arrivâmes comme convenu sur la plage du Martinez où Marilyn nous attendait avec son mari, vers neuf heures du matin – très professionnel ! Je la prenais en photos sous toutes les coutures - elle avait un bikini fuscia – tandis que Theo l’interviewais.
De retour à Arboras, notre repaire, je développai le film dans des conditions de confort dignes des tranchées de la guerre du Vietnam et envoyai les images, avec l’article de Theo, à Brian qui publia le tout dans l’édition du Week-end suivant : pleine page, 9 colonnes à la une. (Eh ! oui, le Cape Times était imprimé sur neuf colonnes.) La gloire !
Notre carrière de grands reporters se confirmait.
Bientôt nous trouvâmes la maison où nous pourrions vivre respectivement avec nos femmes et, pour chacun, nos deux petites filles, et couler des jours heureux entre machines à écrire et voyages pour le compte des titres les plus prestigieux…
Marilyn est morte la semaine dernière. Theo, je ne sais pas ce qu’il est devenu. Johnny Keyes, le partenaire noir de Marilyn n’est peut-être plus en vie. Mais je me rappelle cette partie de son anatomie, la seule qui apparaissait à l’écran, et l’obsession qu’elle provoqua chez Theo.
En effet, après Cannes, Theo répéta à presque tous les tournants d’une route pourtant très sinueuse : Ach sis ! mann ; Those poor little girls. Ces pauvres petites filles, c’étaient les siennes. Theo réalisait qu’en quittant le pays de l’Apartheid pour l’Europe des Lumières (passons vite sur ce terme conventionnel !) il exposait sa descendance à un sort plus terrible que la mort ! (Worst than death !) Et le membre de Johnny Keyes hanta ses jours et ses nuits tout le reste de son séjour en France. (Peut-être se réveille-t-il encore la nuit, en nage, s’il vit encore ?) Et l’image du visage si pur de Marilyn, subissant les immondes assauts, venait se plaquer sur les angéliques têtes blondes de ses enfants ; la prunelle de ses yeux…
Theo, une fois l’article rédigé, entra bientôt dans un état cataleptique. Je l’installai comme je pus dans les ruines que nous avions finalement achetées pour notre projet. Dans un deckchair 1900, où Madame Arboux lui apportait tomates et salades – le pôvre ! Il ressemblait à ce tableau de Byron mourant ou Sardanapale - sans le massacre de ses maîtresses, mais avec cette cruauté désespérée dans le regard que Delacroix a peinte… Il ne se laissait non pas mourir, mais aller pour que l’on se charge de lui ; qu’on l’emmène loin de cette civilisation immonde où le sperme d’un nègre était blanc…
On le rapatria à la condition qu’une fois de retour, il ne quitterait plus l’Afrique du Sud.
En apprenant la mort de Marilyn Chambers, d’abord le nom ne m’évoqua rien. Et puis, très vite, quand même, je me souvins.
Je me souviens surtout de l’innocence du charmant visage de l’actrice américaine. C’était une de ces jeunes filles, comme j’en avais connues à Abington Senior High, et que j’aurais été heureux de sortir ; fier de présenter à mes amis, à ma famille. L’épouser, peut-être…
Pour le reste, bien sûr, pour ce qui est de ce que nous avions vu, Theo et moi, eh ! bien, comme pour chacun de nous, il suffit de pousser la porte de la chambre verte…
Ach Sis ! Mann ! Poor little girl…
Inscription à :
Articles (Atom)